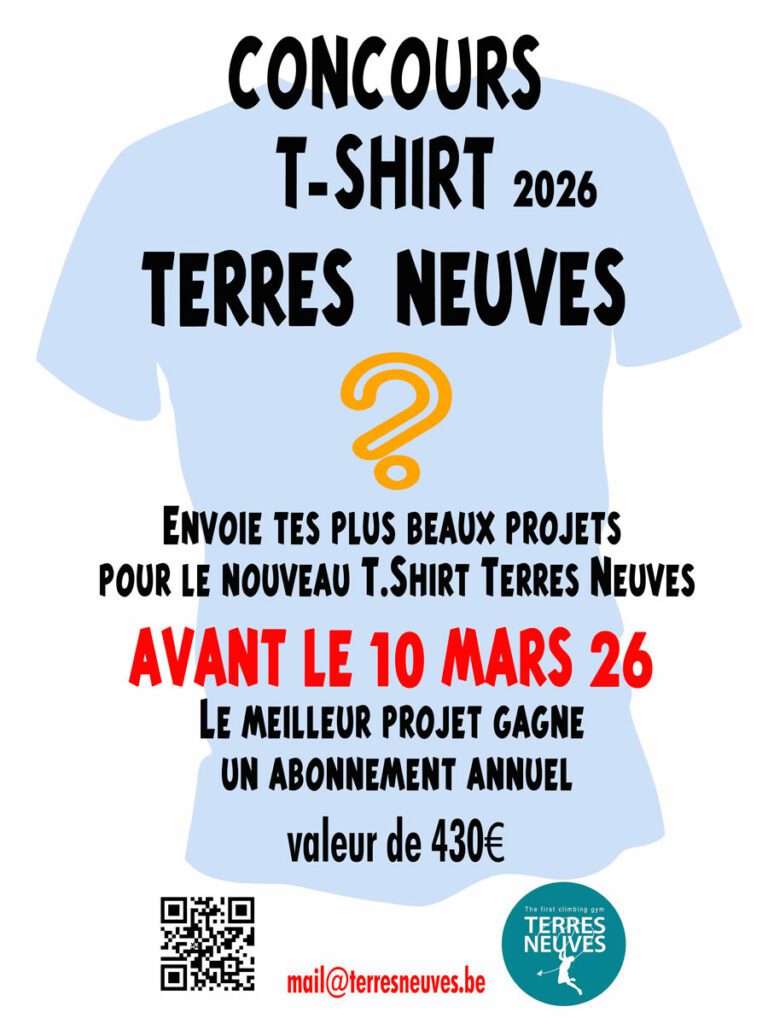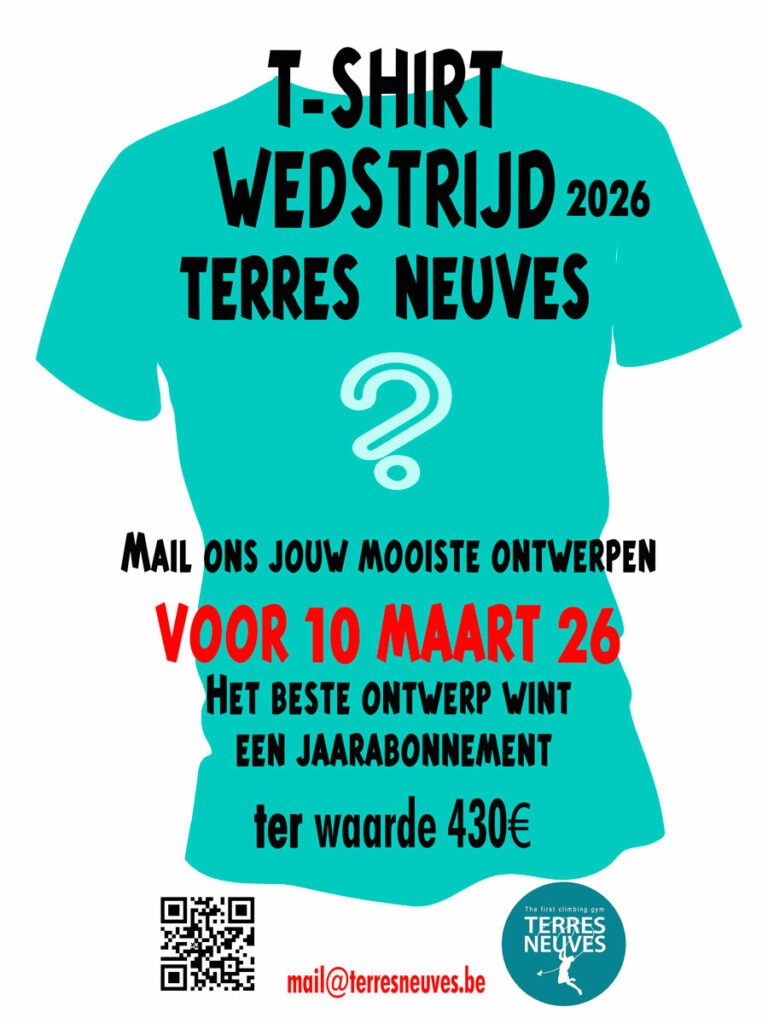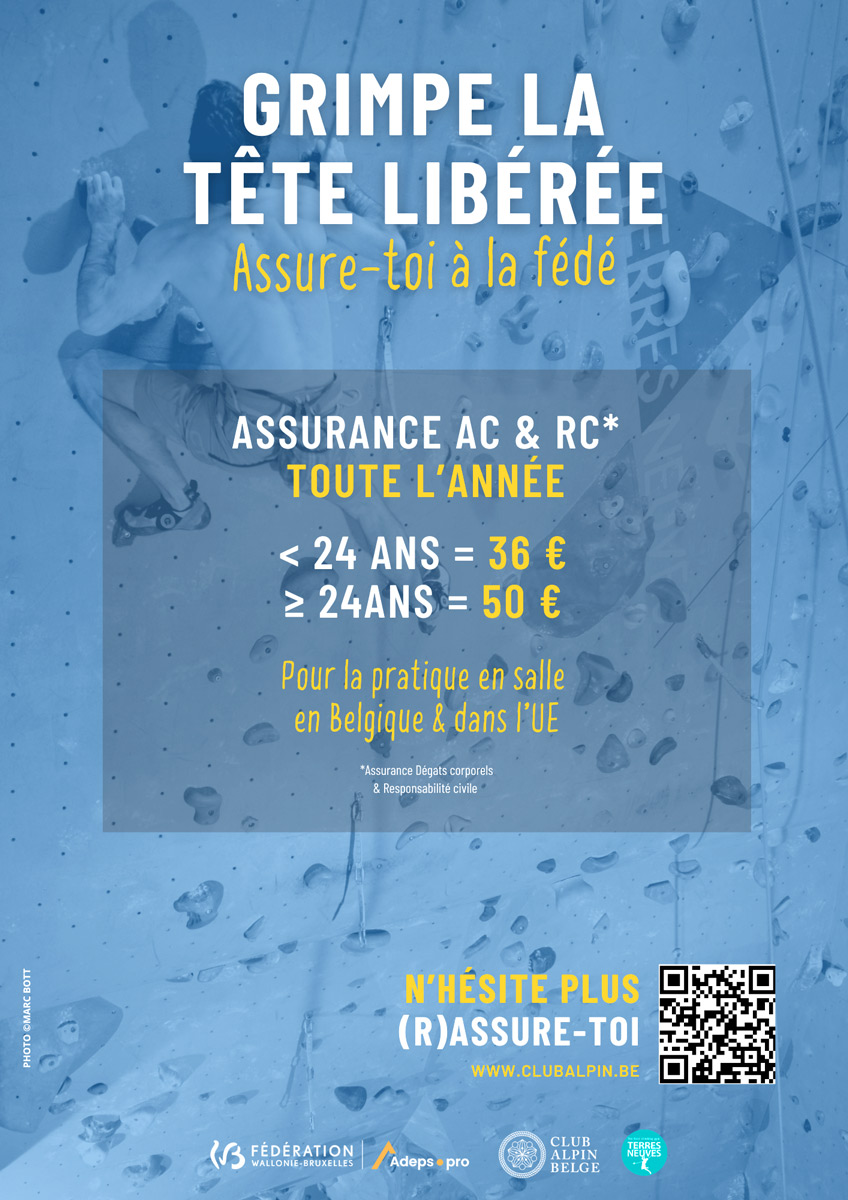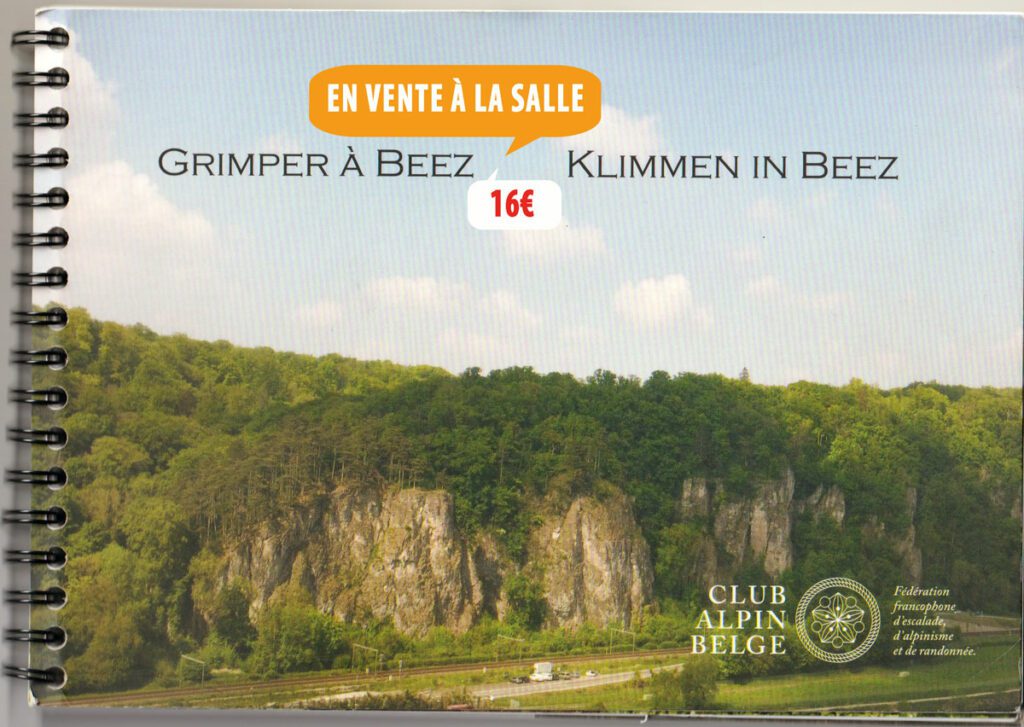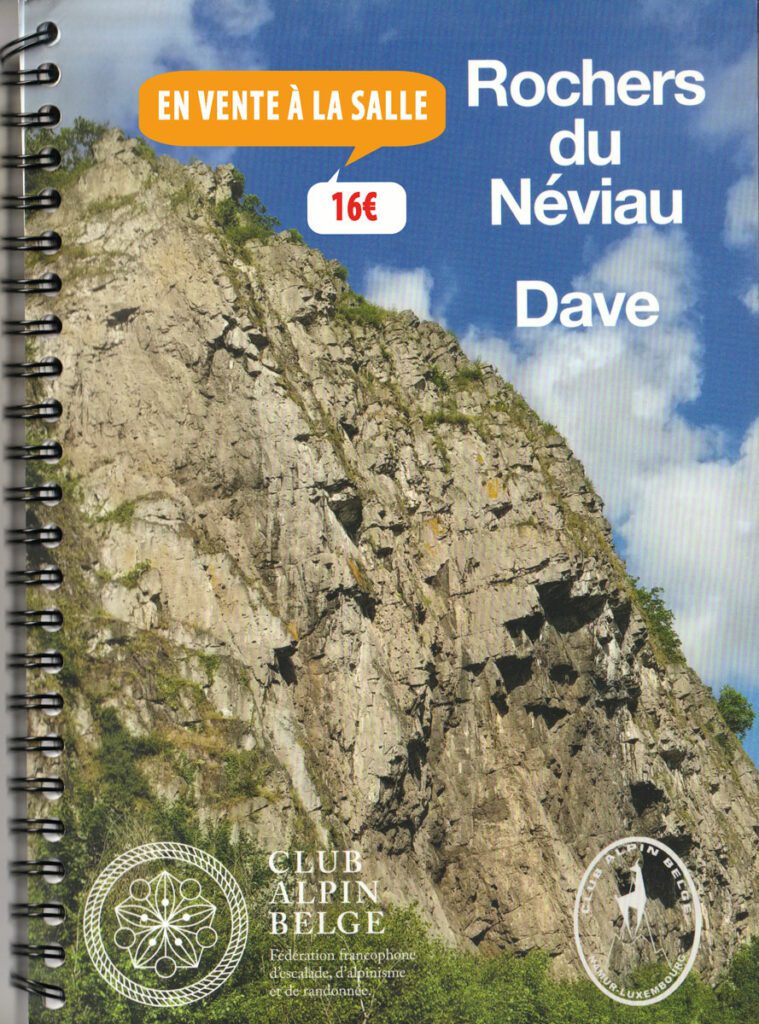Bernard Marnette
Sans doute Néandertal a-t-il été le premier homme à apprécier les rochers de Freyr pour leurs hauteurs, leurs structures diverses et leurs formes variées.
Bien plus tard, les peintres et les écrivains du XIXe siècle décrivirent les charmes de ce merveilleux site de la haute Meuse. Il faudra pourtant attendre le début du 20e siècle pour que ces rochers soient véritablement pratiqués par les adeptes de l’escalade.
C’est en 1930 que la première voie y sera ouverte par Xavier de Grunne à la Tête de Lion. Celui-ci n’est pas venu seul ! Parmi ses compagnons se trouve le Roi Albert Ier. Cette première visite sera donc un peu tardive (les rochers de Dave, Yvoir, Chaleux … ont déjà été visités) mais royale.
À partir de ce moment, de nouvelles voies seront régulièrement tracées sur l’ensemble du massif.
Au passage, les grimpeurs donneront noms à certains rochers : les Cinq Ânes, la Nouvelle Jeunesse, le Pape, les Autours…
Les premiers noms de voies apparaissent. Ils portent en général le nom du « conquérant » mais les voies se multiplient plus vite… que les ouvreurs, de nouveaux noms fleurissent rapidement. Ils seront imposés par l’instant de grimpe. Naîtront ainsi au cours des décennies des toponymies à la fois poétiques (l’Éden), évènementielles (l’Asiatique), nostalgiques (ex-fan de sexto), référentes (Éperon Walker), militantes (Héroïne), didactique (la Ragazza di Finale)… dolomitique (le Spigolo).
Les premiers explorateurs des rochers de Freyr sont issus pour la plupart de milieux bourgeois, voire de la noblesse, cela n’empêche pas un peu d’excentricité et de témérité.
Camille Fontaine, par exemple, personnage hors du commun, tant pour ses qualités d’excellent rochassier que par son style de vie, ouvre la voie du Pape au rythme d’une symphonie. Le chauffeur de son second de cordée, mélomane reconnu, fait résonner, depuis l’autre rive, une musique que l’on devine wagnérienne…
Charles de la Vallée-Poussin franchit allègrement la très difficile fissure des « cinq ânes », sourire aux lèvres, cheveux laqués, en col cravate et veston sport !
René Maillieux n’hésite pas à traverser la Meuse à la nage pour aller grimper sur les falaises voisines de Freyr , celles de « Al rue ».
Le groupe des « supers », qui a repéré une sortie directe de la « Pino-Prati », ose une approche mais butte sur cette fissure très difficile. Le téméraire Henri Renier arrive aussitôt et se lance dans ce passage extrême pour l’époque.
Son ami, Haroun Tazieff, qui ne pense pas le passage
réalisable va d’urgence au sommet du rocher pour, éventuellement, lui lancer une corde. « Que nenni » … rétorque Henri qui franchit la fissure sans coup férir.
Les premiers noms marquants de l’escalade belge se démarquent peu à peu.
De Grunne, Fontaine, Mallieux, Lecomte… sans oublier les demoiselles, ainsi Kiki Meersman réalise la première féminine de la « Roche Al Lègne » en plein hiver 1933, au-dessus d’une Meuse entièrement gelée.
Dans cette période de découvertes il ne faut pas sous-estimer l’action de la famille royale qui fait notamment forger des pitons à Laeken.
Albert Ier fait deux tentatives à la « Roche Al Lègne » avant qu’elle ne soit gravie. Lui et Léopold seront parmi les premiers à tenter la Directissime
D’autres auront plus de chance et bon nombre de nouveaux itinéraires voient le jour jusqu’à la guerre et même pendant (Henri Renier ouvrira les « Zig-Zag » en 1943).
Durant cette période trouble, le camping étant interdit, on prendra l’habitude de dormir dans les grottes et les abris sous roche assez nombreux dans le massif.
Après la guerre, le développement des loisirs va amener de nouvelles têtes sur le plateau, c’est l’époque des Barbier, Didot, Duchesne, Focquet, de Radzitzky… et de nouvelles infrastructures : Jean Duchesne construit, en 1959, le refuge qui porte son nom sur le plateau du point de vue.
C’est l’époque de la « pâtisserie » qui deviendra plus tard le mythique café des grimpeurs « le Chamonix » grâce à Hubert et Marcelle.
La démocratisation des loisirs amène de nouvelles têtes mais aussi de nouvelles mentalités qui sortiront le milieu d’un certain académisme.
Ce sera « la guerre des pitons » durant laquelle les jeunes grimpeurs qui déséquipent les voies sont poursuivis par la police suite à une plainte en bonne et due forme de la direction du CAB.
Cette affaire est liée au développement de l’escalade libre, ce que chez nous on appellera « le jaune ». Cette appellation vient du fait que Claude Barbier et un groupe d’amis (J. Delderenne, E.Abt, C.Delvenne…) peignent en jaune les pitons qui ne servent qu’à l’assurage et que l’on peut franchir en libre (sans se tirer dessus).
Ce sera aussi l’époque de l’affaire du caravaning à Freyr ou les promoteurs s’en prendront à la beauté du plateau. Les grimpeurs feront là, pour une fois, cause commune.
La démocratisation amène du beau monde (Français, Hollandais, Allemand, Luxembourgeois…)
Freyr deviendra pour un temps la falaise des Parisiens. Le club de Billancourt y arrive par cars entiers.
Il y a là bon nombre de gros bras de l’alpinisme français : Paragot, Berardini, Lainez, Mazeaud, Troskiar… Ils répètent les grosses voies de l’époque et il en ouvre plusieurs (le Toit du Monde, les Tourtereaux…)
Parmi ces itinéraires il y a les grandes voies d’artif, ouvertes avec bivouac. C’est la spécialité de certains belges comme Jean Bourgeois ou Jean Alzetta. Il s’agit de voies ouvertes en escalade artificielle.
Il faut une grande patience et beaucoup de temps pour placer le matériel adéquat dans les fissures bouchées du rocher du Pape par exemple. Le matériel nécessaire est important et varié.
À cette époque, beaucoup de grimpeurs fabriquent eux-mêmes leurs pitons. Il en ressort tout un savoir-faire que l’on va, notamment, chercher dans les petits ateliers métallurgiques wallons réputés dans le monde entier. Mais, on fabrique aussi du matériel d’escalade sous le manteau dans de grosses sociétés : Solvay, Cockerill, FN…
C’est l’époque où les falaises servent d’initiation à la montagne mais aussi d’entraînement et de perfectionnement de techniques.
Ce sera moins le cas à partir des années 70 où l’escalade libre s’imposera et sera de plus en plus pratiquée pour elle-même.
En 1980, les grimpeurs s’entraînent de plus en plus spécifiquement. Ils sortent des fissures grâce au nouveau matériel (gollots, spits, broches…) qui permettent ainsi un assurage plus sûr. On le place où l’on veut, on peut négliger la sacro-sainte fissure jadis indispensable pour placer les pitons, on évite ainsi les lignes de faiblesse : on vise plus haut, plus dur !
Au niveau vestimentaire, la blouse fluo remplace le pull de montagne, le collant, le knicker, les chaussons d’escalade les bottines de montagne.
Le niveau explose. Les premiers 7 apparaissent. En 1986, le même jour, les deux premiers 8a de Freyr tombent : Karkass (A. t’Kint) et Excalibur (P. Masschelein). Il faut attendre 2002 pour le premier 8c. Nicolas Favresse gravit « le Clou » qui restera longtemps la voie la plus dure du massif.
Si les Belges se distinguent, les autres nations ne sont pas en reste. Parmi les meilleurs Allemands, Hollandais, Français, Luxembourgeois quelques grosses pointures : Steve Brancroft gravi le libre « la Sirène » et les « trois Saurets » dès 1980, quelque années plus tard, Simon Nadin réalise à un « à vue » dans Schwarzenegger et Isabelle Dorsimond, toujours dans « Schwarz » le 1er féminin.
C’est le bleausard Kevin Lopata qui réalise le premier 8c+ en libérant « Galaxy »
C’est aujourd’hui « Schogun » (réalisé par Loïc Derby en 2022) qui est la plus dure de Freyr avec une cotation annoncée 9a.
Même si certains grimpeurs belges sont parmi les meilleurs d’Europe, si pas du monde (J.M Arnould, A t’Kint, Godissart, Lorenzi, Masschelein, de Sheppers, Muriel Sarkani, Isabelle Dorsimond, Anak Verhoeven chez les filles), cela est parfois compliqué.
Rien qu’au niveau des cotations, cela discute souvent et des polémiques enflent. Il faut dire que depuis « la libération » des premières voies dures, Freyr est considéré comme une falaise aux cotations exigeantes. Le point de départ étant l’ascension en libre de « l’Enfant » par le célèbre parisien Jean-Claude Droyer dont la sévère cotation vaudra à la voie la réputation de 6b, le plus dur du monde (aujourd’hui 6c).
Ces années seront aussi l’occasion d’expériences particulières : les solos extrêmes.
Cette pratique sera portée à son paroxysme par quelques-uns. En 1981 déjà, Jean-Michel Stembert réalise ainsi les « Trois saurets », la voie la plus dure en « tire-clou ». Il est immédiatement suivi par Johan De Schepper (puis par Alec Bronitz) qui s’adjugera aussi des 1ers solos de « l’Enfant » et du « Pilier Cromwell ».
Au tournant du siècle, les voies dures se banalisent. Les voies de 7 et 8 sont régulièrement répétées mais, ce sera aussi une période d’intenses activités d’équipement de voies nouvelles dans lesquelles s’illustre surtout Pierre Masschelein pour les voies dures mais aussi Marc Bott, Philippe Lacroix (alias Bibiche), Marc Debaecke et quelques autres dévoués.
Les années 2000 verront aussi les rééquipements qui permettent le développement de la moulinette (technique importée des salles d’escalade) et le réajustement de certaines lignes permettant ainsi de combiner et d’augmenter encore le niveau.
De nouvelles activités se développent comme le Highline.
La topographie est régulièrement remise à jour par l’important travail de Marc Bott.
Mais, l’essentiel reste immuable : l’Al’Lègne, le Pape, la Jeunesse, les Cinq Ânes… font toujours rêver la jeune génération à la recherche d’évasion et de contact avec la nature.
Somme toute, les choses n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque des pionniers (où l’on pensait les crampons indispensables pour tenter l’Al Lègne).
Bien sûr, l’aspect aventureux de l’escalade s’est réduit à force d’équipement, de nettoyage et d’aseptisation. On y a mis les moyens, il est vrai mais qu’importe l’émotion est toujours là et la jeune génération regarde toujours vers le haut.
Comme le disait notre Claude Barbier national,
« Tous mes moyens sont sensés, mes mobiles et mon but sont fous ! »
Bernard Marnette
Biblio :
Borlée Jacques : De Freyr à l’Himalaya (Ed. Didier Hatier – 1987).
Marnette Bernard : Petit lexique toponymique des rochers et des voies d’escalade de Wallonie (Ed. Serac – 2013)
Marnette Bernard : Les falaises de Freyr : Un monde à découvrir (in : Freyr-sur-Meuse, )– Ed. Trela – 2013)
Marnette Bernard : Escalades Royales (Ed. Nevicata – 2016)
Sebille Mark : De Speeltuin van de koningen (Ed. Mark Sebille – 2019)